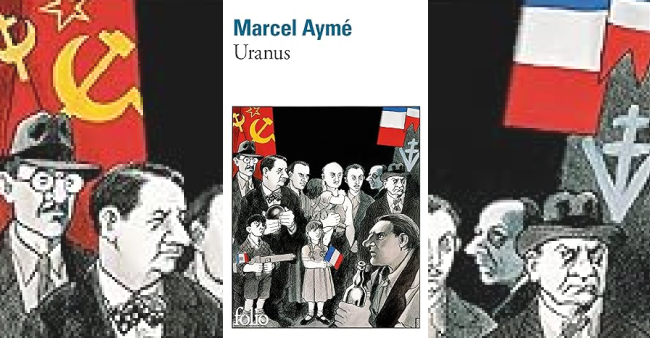Renaud Papillon Paravel : chrysalide et crustacés

Ancien graphiste, musicien issu de l’autoproduction, le Toulousain Renaud Papillon Paravel signe avec “La surface de réparation” un premier album intriguant. Celui qui n’est pas musicien, mais écrit des chansons est à la fois blagueur et pince-sans-rire. C’est un fou de mots, de mer, et un homme proche de la nature.
Par cette matinée froide de Paris en plein février 2003, assis dans un café de la Bastille, Renaud Papillon Paravel n’est pas dans son élément. Son univers, c’est le sud et le bord de mer. “Certains vendraient leur mère pour être reconnus au restaurant“, explique Paravel. Lui sait qu’il ne quittera pas sa mer pour rentrer dans le show-biz parisien. Alors à Paris, il commande de la menthe… à l’eau, et ne quitte pas son bonnet et son anorak. Nous sommes à la veille de son deuxième concert. Un moment qu’il appréhende au plus haut point. Emmitouflé, Renaud Papillon Paravel se dévoile par les mots. Normal, c’est certainement la chose qu’il maîtrise le mieux. Avec l’humour pince-sans-rire.
Propos recueillis par Jean-Marc Grosdemouge.
Renaud Papillon Paravel : J’ai sorti mon premier album autoproduit, “La surface de réparation”, en juin 2001. Je l’ai envoyé partout, et c’est arrivé aux oreilles d’une major, qui l’a signé. Il est donc sorti en mars 2002 chez BMG. Au départ, je suis graphiste et photographe. C’est ce que j’ai fait pendant une dizaine d’années : au début dans les fringues, puis dans la musique. Je faisais des affiches de concerts et des pochettes de disques pour des Toulousains (comme Moos, NDR). Petit à petit, je me suis approché des gens qui me plaisaient le plus, car la musique me tentait depuis longtemps. Certains sont devenus des potes, et j’ai commencé à élaborer mon projet. Quand tu connais les bonnes personnes qui vont pouvoir t’aider, avec les doigts qui bougent au bon moment sur la bonne note, ça facilite les choses (sourire) ! J’ai construit mes textes avec les idées que j’avais, mes ambiances aussi, des squelettes de morceaux. Les musiciens ont joué les parties que je leur ai décrites, pour que ça ressemble à un disque. Je voulais que ce soit homogène.
Jean-Marc Grosdemouge : Ton envie de faire de la musique est née quand ?
Il y a longtemps, quand j’étais tout gamin, à dix sept ans. Avec un copain, dans notre chambre, on avait répété trois ou quatre fois. Notre groupe s’appelait Les Cérumens. Ça te donne une idée de la catastrophe, c’était terrible !
C’était hard ?
C’était immonde, on tâtait, on hurlait. Le premier titre s’appelait “Bouffe ta pizza et ferme-la”, c’était horrible (rire) !
Tu avais déjà beaucoup d’humour ? On retrouve pas mal de jeux de mots sur “La surface de réparation”.
J’adore ça, mais de manière froide… Mon truc, c’est pas l’humour des clowns. J’aime les bonnes blagues avec un sérieux terrible : ça m’a toujours plu.
Il y a beaucoup d’allusions humoristiques, et aussi des mots crus sur ton album. Et des jeux de mots …
J’ai compensé mon manque de culture littéraire par une floraison de mots. La sonorité des mots me fait quelque chose. Ma démarche, ce serait d’y ajouter du sens. J’aime bien les jeux de mots qui vont plus loin que l’humour. Comme quand tu dis : “est-ce que j’ai le bocal ou est-ce qu’il faut tuer le poisson caché derrière mon front ?” Ça a deux sens, mais en même temps, il faut y prêter de l’attention pour comprendre.
Chez toi, le jeu de mot n’est pas forcément synonyme de rire. Il faut comprendre que le plongeur de la chanson qui ouvre l’album est plongeur dans un restaurant de crustacés.
C’est caché. Il faut écouter, réécouter. Certains, à la troisième écoute, n’ont toujours pas compris. Après, c’est comme les mots croisés. Quand tu fais toujours les mots croisés d’un type, tu es habitué à sa façon de rédiger les définitions. C’est pareil pour mon disque : les gens s’habituent à ma manière d’écrire, le tissage de mots et de phrases.
Avant même d’écouter ce disque, sa pochette frappe. C’est toi, l’indien sur la pochette ?
C’est moi, vieilli. C’est un montage que j’ai réalisé : je me suis vieilli avec le visage de l’indien qu’il y a derrière. Il doit avoir soixante balais et j’ai mélangé mon visage et le sien.
Ton vrai nom est Renaud Paravel. Pourquoi avoir ajouté Papillon ?
Pour diverses raisons, qui ont trouvé leur sens. Depuis longtemps, je fais très gaffe aux ours des Pyrénnées. Des vrais ours de souches pyrénéenne, il y en avait 250 en 1900, et il en reste cinq ou six actuellement. Chacun a son nom, et le dernier mâle s’appelle Papillon. Il a mon âge.
Tu es à la fois le dernier des Mohicans et le dernier ours ?
J’adore les Indiens, ce sont des images qui me plaisent. D’où la pochette, même si n’a rien à voir avec ça dans le contenu. Et puis le film “Papillon” avec Mc Queen, j’adore ! Le type qui s’évade de son bagne, Charrière. Il avait été embarqué par les flics à 17 ans. Il n’avait rien fait, si ce n’est être trois jours en retard au service militaire. Il avait un papillon tatoué sur le torse. Tout ça a fait que je me suis dit : “mais, c’est pour moi, ce nom !” (sourire). Puis j’aime le Roquefort ! (rire)
Comme on évoque tes références, quelles sont-elles en matière de musique et de livres ?
Je suis très nul. J’ai une culture hyper réduite … C’est dramatiquement vrai !
Pourtant, à écouter ton album, on a l’impression que tu as pioché dans plein de trucs …
Ma culture est essentiellement fondée sur ce que j’écoute attentivement depuis toujours. J’écoute les gens parler dans les émissions de télé ou de radio. Je suis capable de retenir une anecdote que j’ai entendue à huit ans, parce qu’elle m’a impressionné. Tout comme des gens lisent quatre livres par jour, je peux discuter sept heures quelqu’un. J’ai discuté avec un pêcheur de quatre vingt ans près de Collioure : il a passé dees heures à me raconter sa vie en mer, à pecher. Il était rempli d’informations, de choses incroyables qui faisaient un bien fou à écouter. Ce type était plein de vérités, aucun faux-semblant. Des gens commes ça me touchent beaucoup. Parler avc les vieux, j’adore. J’aime les histoires, même si c’est les histoires de la guerre. J’aime écouter les vieux. Je suis comme les africains pour ça : les vieux font partie de mon paysage. Tous les vieux ont quelque chose à nous apprendre. Je te parle pas de vieux cons (sourire), mais des vrais vieux, qui étaient comme nous il y a quelques années. Mais on l’oublie. Sous la carapace de la peau qui se frippe, c’étaient les mêmes que nous. On finira comme ça si on a la chance d’y arriver.
Que réponds-tu si on te dit que ton album fait penser à du Gainsbourg ?
Pour moi, c’est une idole, je ne peux pas me permettre d’y croire une seconde. Même si en écoutant Gainsbourg, je me dit parfois qu’il a aussi fait quelques merdes. Peut être que ma meilleure chanson est mieux que la pire des siennes…
Ta musique est aussi un peu celle que pourrait réussir Yves Simon ?
J’aime bien Yves Simon. Je me rappelle “J’ai rêvé New York.”
Lui a l’air dépassé par le technique en ce moment…
Je ne connais pas ce qu’il fait depuis quelques années. Ce qu’il faisait dans les années 70, c’était bien. Moi, l’ordinateur, j’en ai l’expérience en tant que graphiste. Ce n’est pas une bestiole que je découvre. Je travaille de la même anière comme graphiste et comme musicien. Je prends des choses à droite à gauche, je découpe, je colle, j’aime bien la phrase de Picasso : “Quand je n’ai plus de rouge, je mets du bleu”. (rire) Le tout c’est d’arriver à faire ce qu’on voulait … Si c’est réussi, c’est mieux.
Tes samples, c’est de la musique classique ? “L’homme à la peau de serpent” par exemple ?
On a rejoué ce morceau, mais ça, c’est un vrai sample, le seul de l’album, pas déclaré, d’ailleurs. C’est la B.O. du premier “King Kong” en 1925. Quand King Kong arrive sur l’île…
Comment tu connais ça ?
J’achète des vieux disques dans les vide-greniers. Des fois, t’achète vingt disques nazes pour dix francs, et si tu as deux secondes qui t’intéressent, c’est bon, ça vaut dix francs. Tu prends ce qui t’intéresse -moi je ne prends jamais les mélodies, et après, si tu veux, tu les revends. J’achète des disques qui m’intriguent : des disques de valse, d’orchestres années 30. Là, je viens de trouver un petit son sur une intro de Joséphine Baker, pourquoi pas faire un truc avec ça ? Des fois, ça fait des matières : le son a une âme en lui, et il peut t’emmener dans un axe de mélodie, te guide vers quelque chose vers lequel tu ne serais peut-être pas allé naturellement, tu te laisses dériver vers des choses qui ne sont pas naturelles pour toi et vers lesquelles tu as pourtant envie d’aller.
C’est un déclencheur ?
Oui. Sur l’album, j’avais commencé à travailler sur des samples. Après on a tout cassé et refait pour retrouver des sensations semblables à celles du sample. Je m’appuie sur le rythme du sample, je construis, et ensuite, on peut m’enlever le tapis sous le pied et refaire de façon proche. Je travaille pour me créer des matières de base, comme ça parce qu’à la base, je ne suis pas musicien. Parfois, en écoutant un morceau à la radio, je me dis : “si j’avais eu cette musique là, j’aurais fait ça” et je chante par dessus le mec. Je le note, je note aussi le tempo. Pour le reste, je fais écouter aux musiciens cette rythmique et ces paroles et on construit tout autour une chanson dans cet esprit. Souvent voilà comment ça commence : je m’assieds sur mon lit avec un casque, dans lequel j’écoute un sample tourner indéfiniment. J’ai mes papiers avec des mots, des phrases, et j’essaie de construire.
Sur le premier album, tu as enregistré avec combien de personnes ?
J’ai enregistré avec des gens que j’aimais bien, mais pas toujours les mêmes. En tout, il y a eu une dizaine de personnes différentes. Sur le deuxième, auquel je travaille actuellement, l’essentiel se fait avec deux musiciens qui m’accompagnent sur scène. Ensuite, je le ferai remanier par des gens qui font de la musique électronique, et que je connais.
Avant de revenir avec son deuxième album, Renaud Paravel va défendre “La surface de réparation” sur scène, en compagnie de deux claviers et d’un guitariste. Paravel ne joue de rien. Il se “contente” de tenir le micro. Pourtant, monter sur scène est une expérience un peu effrayante pour lui. A la veille de son concert à l’Européen, il nous confiait avoir le trouillomètre à zéro et se demander, avec humour, pourquoi il n’était pas resté un graphiste pépère. “Je vais demander à ma femme de se mettre au premier rang, comme ça je pourrai la voir, comme à la maison. Ça me rassurera.”
Ce concert, donné le 5 février dans le cadre du festival Tout Azimuth, est le deuxième de la carrière de Paravel, qui s’en tire comme il faut. Paralysé par la peur au début de son set, il reste assis sur un tabouret, crispé et fixe parfois le sol. Sur un pupitre, ses longs textes, qu’il récite d’une voix blanche et grave. Le concert avançant, Paravel arrive à se détendre, à parler un peu. Et même à blaguer lorsqu’un sampler a un problème : “d’habitude, le problème, c’est moi“, glisse-t-il. Pince-sans-rire encore une fois. Et le public, qui le rappelle, l’applaudit chaleureusement. Derrière lui, sur la scène, une sculpture en bois : un arbre, ou une main grande ouverte. Besoin de nature, encore. Et des vidéos qui défilent, avec des végétaux, ou des poissons.
“La mer me fascine, explique Paravel. Je ne vis plus à Toulouse : je me suis rapproché de mon élément. Depuis un an, je vis près de Perpignan. Je rêvais depuis longtemps d’avoir un bateau et d’habiter près de la mer donc j’ai franchi le pas et je suis parti m’installer dans un petit village des Corbières, à quelques kilomètres de la mer, pas très loin de la frontière expagnole. Je vais à la pèche et je me suis fait mon studio dans un très vieille maison en pierre, où j’habite avec mes enfants. Le village, c’est un mélange d’exotisme : les commerces sont français, mais c’est quasiment espagnol, avec tout ce que ça a de sympa, comme les palmiers. Je vais avoir assez de sous pour m’acheter un bateau, bientôt. Je me suis fait voler l’autre l’été dernier.“
Rester dans le sud, c’est important ?
Cela fait partie de ma vie. Les Corbières, c’est une merveille : il y a des sources, des rivières sauvages sur des plaques de calcaire, des criques avec du sable, faire du bateau, te ballader en hiver dans des endroits où tu aurais pu tourner des westerns. Là où je suis, une vie entière ne suffirait pas pour tout connaître.
Tu fais partie des artistes qui viennent de la province, je pense à Mickey 3D, et qui, malgré les contrats à Paris, restent en province ?
J’aime bien Paris, mais vite fait, comme ça. Il faut faire un aller-retour. Chez moi, ça m’apporte plein de choses intéressantes. J’adore le grand Sud : les Landes, les Pyrénnées. Le rectangle Bordeaux-Biarritz, Collioure, Narbonne, j’adore. Si on me proposait de vendre dix fois plus de disques en venant à Paris, je resterais chez moi.
Puisque tu parles de ta vie, le disque est sous-titré “Original Soundtrack of by bizarre life.” Ta vie est à ce point-là bizarre ?
Non. Quand j’étais petit à l’école, on me disait souvent “tu es bizarre”, parce que j’étais un rêveur avec des objectifs farfelus
Un peu dans la lune ?
Oui, toujours fasciné par des trucs, comme les vieilles voitures. J’ai une trentaine d’années, mais j’ai déjà eu 22 voitures. Je les achète et les revends. Ce sont de vieux cabriolets pourris, pas chers, qui me plaisaient. Il fallait que je les aies. Quitter Toulouse pour la mer, c’était un risque aussi, car je savais que j’allais perdre pas mal de clients en tant que graphiste.
Tu n’es pas prêt à tout sacrifier pour te faire plaisir ?
Non. J’ai des enfants, donc je fais attention, mais ma femme l’a compris. On est sur terre le temps d’un éclair, on va pas se faire chier ! C’est vrai, ça va trop vite (rire) ! Il suffit que j’aie à manger, de quoi faire les courses et allumer le chauffage, et après, le reste, je m’en fous presque.
Tu n’es pas là pour faire sauter la banque ?
Certains sont comme ça, ou sont fascinés par la notoriété. Ça les fait bander. Certains vendraient leur mère pour être reconnus au restaurant. La musique ne les intéresse plus : ils veulent juste être des stars. Si jamais personne ne me reconnaît de toute ma vie, je m’en fiche complètement. Ce qui m’éclate, c’est le sentiment que j’ai quand je viens de trouver une phrase qui me plaît, la mettre sur le disque, que ça tourne comme je veux. Ce qui me fait avancer, c’est faire des chansons.
Renaud Papillon Paravel “La surface de réparation”, 1 CD (BMG), 2003